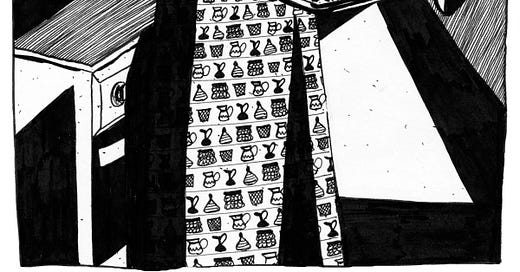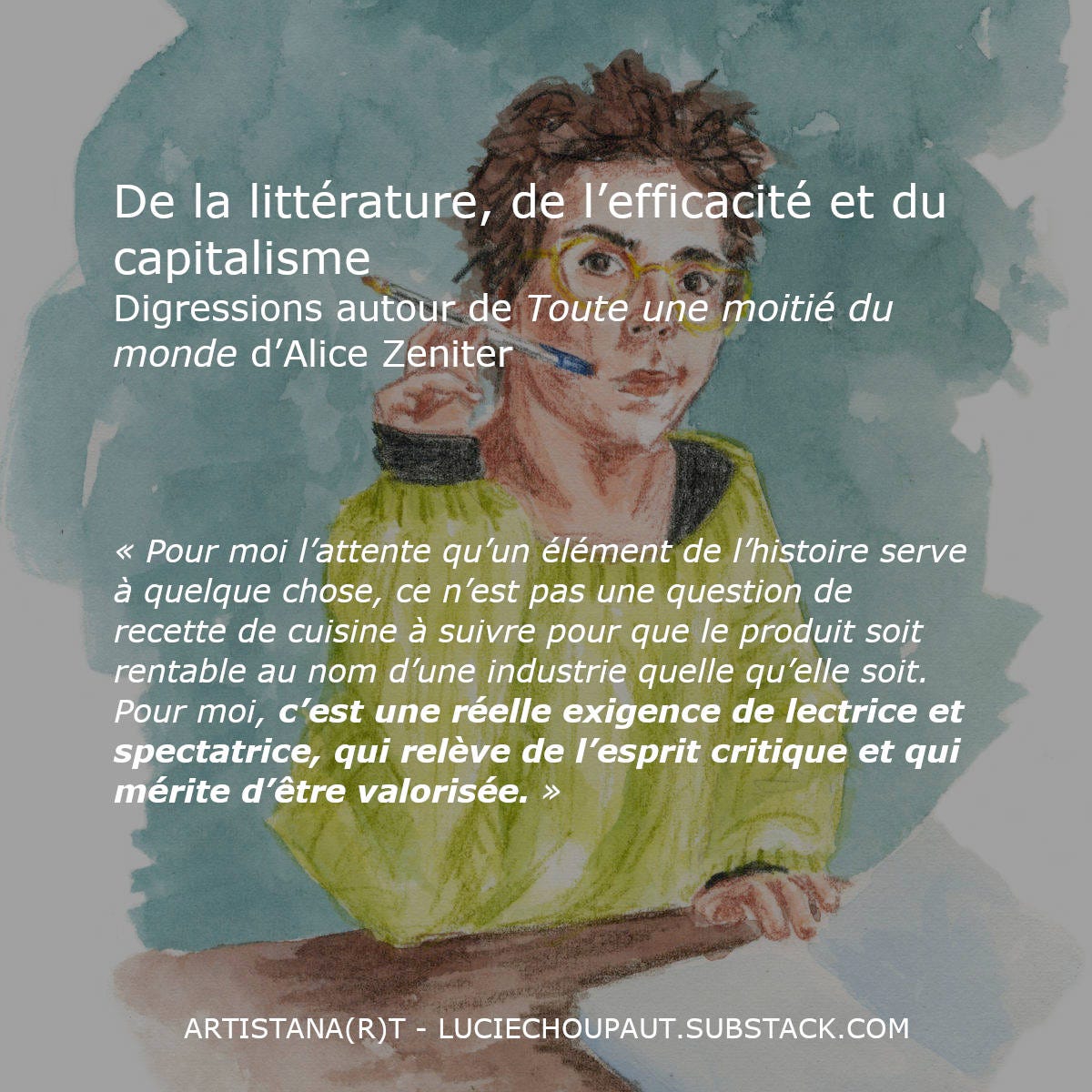De la littérature, de l’efficacité et du capitalisme
Digressions autour de "Toute une moitié du monde" d’Alice Zeniter
J’ai passé énormément de temps à écrire la lettre de cette semaine. À vrai dire, beaucoup trop pour un projet bénévole. Alors même qu’elle est déjà programmée, j’y reviens encore pour corriger et essayer d’affiner des pensées. J’ai peur d’être mal comprise, j’ai l’impression que cela mériterait un développement plus long, sur un autre support. Je vous la livre néanmoins imparfaite et j’espère que la réflexion que j’essaye de développer ne sera pas trop floue et qu’elle vous intéressera. Si c’est le cas, n’hésitez pas à me le faire savoir d’une manière ou d’une autre. D’avance merci pour votre soutien et bonne lecture.
En ce moment, je bois mon thé du matin en compagnie de l’essai d’Alice Zeniter, Toute une moitié du monde, que mon amie Marie m’a prêté. Je ne l’ai pas encore terminé, mais il a fait naître une réflexion très brouillonne cette semaine, et j’avais envie d’essayer de la clarifier en vous la partageant.
En tant que personne qui porte une double casquette d’écrire des histoires depuis presque toujours et de lire de la littérature classique depuis l’adolescence, je me sens malgré tout un peu étrangère à une partie de cet essai (en tout cas pour là où j’en suis dans ma lecture).
La raison, à mon avis, c’est que je n’ai pas fait d’études de lettres1, je n’ai pas lu les textes structurants de la littérature et ma connaissance des classiques se limite à des lectures au premier degré. Je veux dire par là que j’ai lu des romans qui sont des piliers de l’histoire de la littérature, que j’ai adoré ou détesté selon les cas, mais pour des raisons qui me sont intimes et que je n’ai jamais cherché à théoriser.
Je ne me considère pas comme une grande lectrice2, mais il y a des livres importants dans ma vie, comme À la recherche du temps perdu de Proust ou Le bruit et la fureur de Faulkner, qui me classent sans doute dans la catégorie de population des intellos littéraires alors que je ne sais pas ce qu’est la Littérature avec un grand L.
Quand j’écris que je ne sais pas ce que c’est, je veux dire que je ne sais pas la définir et de ce fait, je ne peux pas dire que je lise l’essai d’Alice Zeniter en sachant exactement de quoi elle parle. Certaines des questions qu’elle se pose en tant que lectrice et écrivaine ne sont pas du tout les miennes et cette lecture matérialise assez bien pour moi l’existence parallèle de deux types de livres : ceux de divertissement, qui ne se contenteraient que de raconter des histoires et ceux de Littérature, qui chercheraient à atteindre un but plus noble, celui, je suppose, de faire de l’Art avec un grand A.
De mon côté, il y a de nombreuses années que j’ai cessé d’utiliser des majuscules pour parler des arts et que j’ai renoncé à mon rêve de jeunesse de devenir une grande artiste. À bientôt 40 ans, je me contente d’essayer d’écrire et dessiner des histoires, ce que je trouve déjà suffisamment difficile pour ne pas me rajouter des ambitions démesurées.
Bref, le passage qui a été le cœur de ma digression mentale cette semaine est le suivant :
« Un des modes de lecture dont il faudrait se défaire, c’est celui que Vincent Message décrit comme animé par une logique économique capitaliste : est-ce que ce chapitre, cet élément, cette page, sert à quelque chose ».3
En le lisant, j’ai repensé aux Misérables que j’ai fini de lire pour la première fois à la fin de l’année dernière (trois ans après l’avoir commencé) et aux longues digressions de Victor Hugo, qui si elles sont magnifiquement écrites, ne sont pas toujours utiles au récit et même parfois, je suis désolée de le dire, assez ennuyeuses. Je me suis alors demandée si cette critique que je fais aux Misérables était imprégnée d’une pensée capitaliste qui m’aurait atteinte malgré moi.
L’efficacité est-elle capitaliste ?
Le mot employé par Alice Zeniter dans ce passage est « utilitarisme ». Celui auquel je pense, moi, quand on me parle d’éléments qui servent le récit, c’est « efficacité ».
« Efficacité » est un terme que j’emploie énormément dans ma vie. J’aime que les choses soient efficaces, notamment les histoires que l’on me raconte. Ce que j’entends par « efficacité d’une histoire », en tant qu’autrice c’est la somme des éléments qui devraient permettre au lectorat ou au public d’atteindre l’état émotionnel dans lequel je voudrais qu’il se trouve à la fin. En tant que lectrice ou spectatrice, c’est la somme des éléments du récit qui me permet une compréhension de l’œuvre et une plongée dans l’état émotionnel supposément attendu par l’artiste.
Je crois qu’un petit retour en arrière sur mon parcours s’impose pour bien comprendre ce rapport particulier à la construction d’histoires.
Je pratique le jeu de rôle grandeur nature depuis 2005. Si vous ne connaissez pas, il s’agit d’une activité ludique qui consiste à incarner des personnages en grandeur nature (c’est-à-dire en costume dans un décor à taille réelle) et à vivre une histoire plus ou moins écrite par des auteurices (que l’on appelle dans le milieu des organisateurices). La différence avec le théâtre, c’est que l’on n’incarne pas des personnages pour faire vivre une histoire à un public, mais pour se la faire vivre à soi-même et aux autres participant·es avec lesquels on va interagir et qui sont eux-mêmes spectacteurices de l’histoire.
Il existe des tas de formes différentes de jeux de rôles grandeur nature, des thématiques extrêmement variées, des cultures de jeu très diverses, bref le monde du GN (pour grandeur nature) n’est pas du tout monolithique. En ce qui me concerne, j’évolue dans une frange plutôt expérimentale, explorant des thématiques contemporaines et ayant une approche réflexive de la pratique et donc très critique de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. J’ai écrit et organisé mon premier GN en 2014, Carmen Chabardès, qui raconte l’histoire d’une famille de l’Hérault entre 1905 et 1929 et qui se concentre sur les deuils traversés par cette famille. J’ai ensuite co-écrit et co-organisé un GN en 2017 avec mon amie Stephanie, qui raconte 14 jours d’une résidence de création de danse contemporaine sur une seule journée de jeu, et je suis en train de finir un projet, qui s’appelle La Machine, une métaphore de l’aliénation, qui s’intéresse à la vie d’une prison dans une France dystopique en 2050.

Tous ces projets, très différents dans leurs thématiques et même dans leurs systèmes de jeu, ont pour point commun une chose : une vision d’artiste de l’expérience que j’ai envie de faire vivre aux joueureuses. Mes choix d’autrice et de game designeuse sont tous très dépendants de cette vision et je crois que c’est important pour comprendre ma posture actuelle de romancière. J’ai bien conscience qu’un roman n’est pas un GN, comme il n’est pas une pièce de théâtre, que ce sont des médias différents qui demandent des façons d’écrire différentes, mais je pense que je garde une attente générale sur l’écriture d’histoires (prises ici dans le sens le plus large), quels que soient leurs médias de référence et c’est ce que j’appelle une attente d’efficacité.
Bref, après cette longue digression, revenons sur cette histoire d’efficacité comme signe de la gangrène capitaliste. Je ne suis pas d’accord avec le passage cité plus haut4. Je ne crois pas qu’en tant que lecteurice, le fait d’attendre d’un élément, d’une page ou d’un chapitre qu’il serve à quelque chose soit nécessairement lié à une logique économique capitaliste. Par ailleurs, je ne crois pas qu’il faille se défaire de cette attente. En allant plus loin, je ne suis même pas certaine que ce soit souhaitable.
Je ne crois pas que le fait de ne pas vouloir perdre son temps soit le signe d’une colonisation de nos esprits par le capitalisme. Selon moi, notre temps sur terre étant limité, on a surtout envie de jouir de notre vie et de ne pas se faire chier.
Peut-être que si le capitalisme s’effondrait et que la société dans laquelle nous évoluions était une utopie anarchiste, l’idée de perdre notre temps ne serait pas aussi insupportable qu’aujourd’hui. Peut-être que l’on serait plus enclin·e à passer des heures devant des productions artistiques qui nous emmerdent, mais honnêtement j’en doute. Parce qu’il y a des milliards de choses plaisantes à faire et à expérimenter, qu’on n’a pas tous·tes les mêmes goûts et que capitalisme ou pas, la vie est courte5.
Pour moi l’attente qu’un élément de l’histoire serve à quelque chose, ce n’est pas une question de recette de cuisine à suivre pour que le produit soit rentable au nom d’une industrie quelle qu’elle soit. Pour moi c’est une réelle exigence de lectrice et spectatrice, qui relève de l’esprit critique et qui mérite d’être valorisée.
Je trouve par exemple que le cinéma grand public d’aujourd’hui est particulièrement inefficace en termes narratifs. Les films sont souvent trop longs, il y a beaucoup de scènes inutiles et j’ai personnellement perdu beaucoup trop de minutes précieuses de ma vie à regarder des histoires médiocrement racontées. On n’a pas besoin de 2h30 ou 3h pour raconter une bonne histoire. Yannick de Quentin Dupieux ne dure par exemple qu’1h05, pourtant l’histoire est extrêmement efficace et le film m’a bouleversée.
Pour revenir à la littérature et aux Misérables, je ne pense pas que ce soit un crime de lèse-majesté de dire que certaines scènes du roman sont inutiles, voire desservent l’histoire générale. Plusieurs digressions descriptives sortent totalement les lecteurices de l’état émotionnel dans lequel ils et elles se trouvent après des scènes très intenses, certains éléments sont plutôt paresseux d’un point de vue scénaristique, comme les coïncidences (Marius se retrouve voisin de palier des Thénardier dans une ville aux centaines de milliers d’habitant·es alors que justement il les cherche parce que son père à une dette envers eux, COMME DE PAR HASARD), mais cela n’empêche pas que ce soit un monument, qui vaille le coup d’être lu pour plein d’autre aspects et que la langue de Victor Hugo soit époustouflante de beauté. En revanche, c’est ok s’il vous tombe des mains.
Bref, je ne sais pas si mon cheminement de pensée est très intelligible. Ce que j’essaye de dire, je crois, c’est qu’en tant que lecteurices et spectateurices, nous sommes en droit d’attendre de bonnes histoires et que ces histoires nous soient correctement racontées et cela ne fait pas forcément de nous des pantins du capitalisme, ni des ennemis de l’art au profit du divertissement. Je pense même que si nous augmentions collectivement nos attentes, nous vivrions des histoires plus belles, plus intelligentes et le monde n’en serait que meilleur.
Cependant, gardons aussi à l’esprit que bien raconter une bonne histoire est une chose difficile, saluons donc les efforts de celles et ceux qui se donnent du mal pour le faire. On ne réussit pas toujours, mais c’est important d’essayer.
Je vous remercie de m’avoir lue.
À dimanche prochain.
Les lettres de l’atelier
Cette semaine dans l’Atelier Artistana(r)t, j’ai publié un exercice pour travailler la voix du personnage. C’est un exercice que j’ai trouvé extrêmement difficile à faire et je déteste le texte nullissime que j’en ai tiré. Heureusement pour moi, seul·es les abonné·es premium auront l’occasion de lire.
La voix du personnage
Bienvenue dans l’Atelier Artistana(r)t, une proposition d’exploration littéraire pour les gens pressés. L’exercice de la semaine est une grosse sortie de zone de confort pour moi et, pour ne rien vous cacher, j’ai eu beaucoup de mal à le tester.
Cette semaine sur le blog
L’article de la semaine est consacré au projet que je suis en train de tricoter. C’est un super cardigan et le tricot est une activité toujours aussi formidable.
Mes portraits de maisons
Les maisons sont les personnages d’une histoire, et c’est cette histoire que je vous propose de raconter en illustrant un lieu qui vous est cher. Mon carnet de commandes est ouvert, vous pouvez consulter l’offre via le lien ci-dessous (et il y a même une offre pour les gens pauvres).
Ce n’est pas tout à fait vrai puisqu’en troisième année de licence d’histoire de l’art, j’ai suivi des cours de licence de lettres modernes appliquées à la Sorbonne, auxquels, sans bagage préliminaire je n’ai strictement rien compris. J’ai lamentablement échoué aux examens et abandonné là cette velléité d’être diplômée en lettres.
Ce qui est complètement subjectif. Je ne me considère pas comme une grande lectrice dans la mesure où je termine en moyenne une vingtaine de livres par an, là où j’observe des personnes qui lisent 30, 40, 50 livres par an. Il y a aussi beaucoup de gens qui lisent moins de 20 livres par an et qui me considéreront sans doute comme une plus grande lectrice qu’elles et eux.
Alice Zeniter, Toute une moitié du monde, Paris, Flammarion, 2022. p.107.
Notez que je ne suis pas d’accord avec ce que je comprends du passage cité plus haut. Je n’ai pas lu le texte de Vincent Message auquel fait référence Alice Zeniter, toute cette digression est donc peut-être complètement à côté de la plaque du point de vue du commentaire de texte, mais il me semble que la réflexion générale mérite tout de même d’être développée.