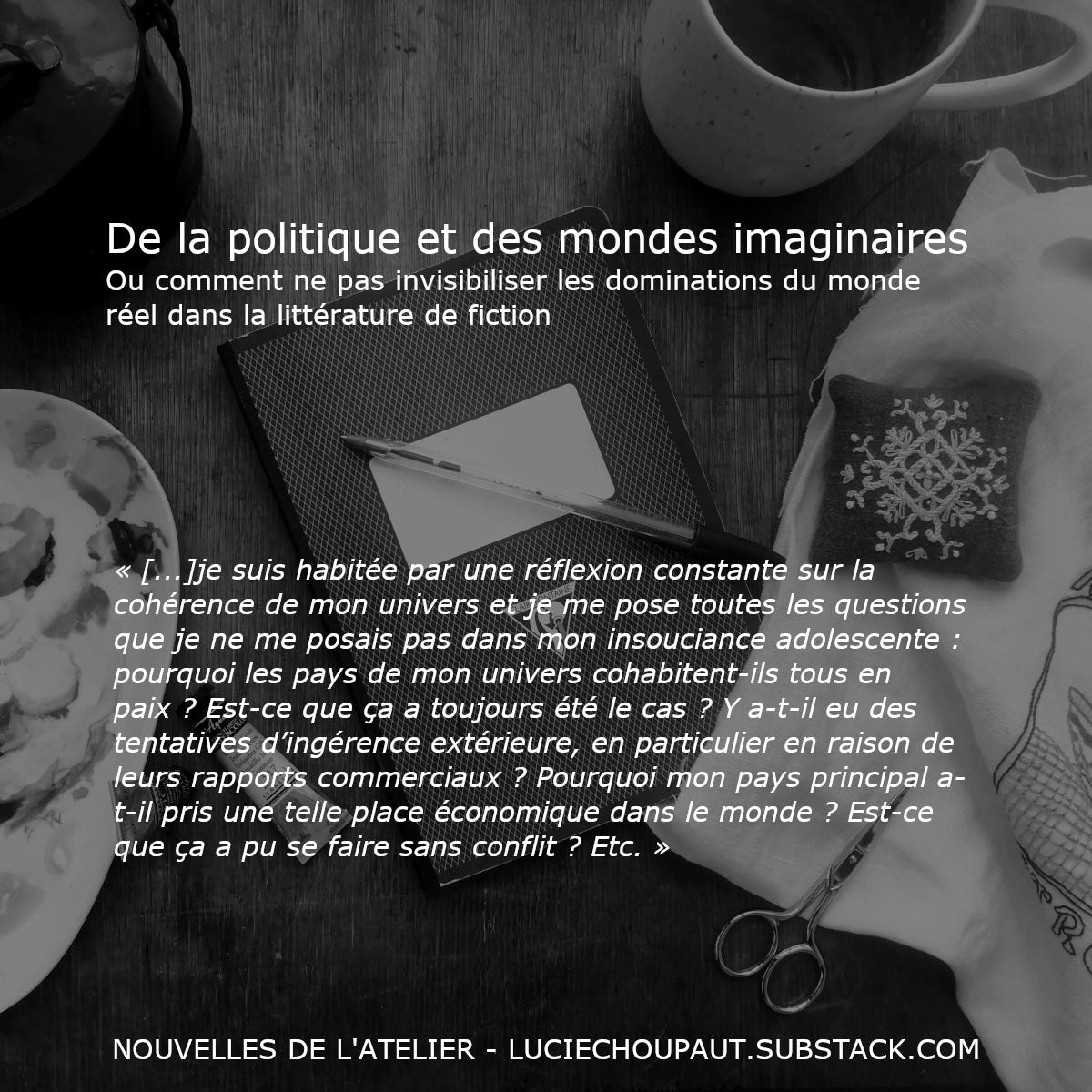De la politique et des mondes imaginaires
Ou comment ne pas invisibiliser les dominations du monde réel dans la littérature de fiction
Quand j’ai commencé à poser les bases de l’univers de mon deuxième roman, Les mirages d’Abalon (qui était à l’époque mon premier), j’avais 15 ans et j’ignorais tout du monde, de la politique, de l’histoire et de la sociologie. Je n’avais aucune idée des ramifications complexes de la géopolitique et mes chaînes de causalité pour expliciter tel ou tel événement dans mon histoire étaient plutôt courtes. De toute façon, à l’époque j’avais seulement envie d’écrire une histoire d’amour et je me foutais un peu du reste.
Aujourd’hui, je m’approche de la quarantaine, j’ai lu un peu de théorie politique (principalement anarchiste) et je me suis plongée dans les sciences humaines et sociales depuis une bonne dizaine d’années, ce qui a forcément imprégné la façon dont j’ai repris le travail sur cette ébauche de premier roman. J’en parlais dans ma toute première lettre comme d’une rénovation de l’extrême.
C’est en effet un gros travail de repartir d’un univers naïf et stéréotypé pour en faire quelque chose de cohérent, valide d’un point de vue politique, mais néanmoins réjouissant, en tout cas autant qu’il l’était lorsque j’avais quinze ans et que j’étais ignorante des maux du monde, me préoccupant seulement de savoir si « blouson orange » allait être ou pas dans la cour du lycée à 10h1.
Aujourd’hui, je suis habitée par une réflexion constante sur la cohérence de mon univers et je me pose toutes les questions que je ne me posais pas dans mon insouciance adolescente : pourquoi les pays de mon univers cohabitent-ils tous en paix ? Est-ce que ça a toujours été le cas ? Y a-t-il eu des tentatives d’ingérence extérieure, en particulier en raison de leurs rapports commerciaux ? Pourquoi mon pays principal a-t-il pris une telle place économique dans le monde ? Est-ce que ça a pu se faire sans conflit ? Etc. Maintenant, je lis le Monde diplomatique, c’en est malheureusement terminé de mon ancienne naïveté béate et c’est donc un énorme travail d’adapter mon univers à l’aune de tout ce que j’ai appris et continue d’apprendre. Sans avoir le syndrome de la bonne élève, mes lectures génèrent des questions, qui elles-mêmes génèrent d’autres questions et il faut arbitrer entre la vraisemblance, l’envie d’écrire quelque chose de globalement sympa et qui ne me prennent pas non plus dix ans de plus à être élaboré.
Pour vous donner un exemple sans trop vous spoiler, l’histoire des Mirages d’Abalon implique un peuple en exil au préalable persécuté par un État fasciste, et ce que l’État d’Israël fait en ce moment à Gaza, au Liban et dans les territoires occupés fait naître des questions auxquelles je n’avais pas pensé. Je trouve compliqué de trouver la juste mesure entre la description d’une violence d’État cohérente, qui ne paraisse pas trop « douce » et mon absence totale d’envie de parler de massacres dans mon roman. Il y a des violences insoutenables que je n’ai aucune envie de décrire, l’écriture devant avant tout pour moi rester un plaisir, mais ce serait faire preuve de beaucoup de naïveté de croire que les mondes imaginaires ne parlent pas aussi de la vraie vie dans tout ce qu’elle peut avoir de pourri.
Bref, en ce moment, je réfléchis en toile de fond à ce que mon écriture ne reproduise pas les systèmes de domination à mon insu, mais je n’ai pas encore tellement de matière personnelle à vous partager sur le sujet. Je vous renvoie donc au blog de l’écrivaine et militante Laura Nsafou, qui travaille sur les questions décoloniales notamment dans l’écriture et les mondes imaginaires.
Abandon et construction
Outre ces questionnements importants, cette semaine a aussi été une semaine complète de rodage de mon nouveau système d’organisation et mon avis est mitigé. Dans les faits, les deux journées supposées être complètement dévolues à l’écriture ne l’ont pas été, j’ai très peu avancé sur les corrections de mon chapitre 6 et je ne sais pas si cela tient à mes difficultés sur ce chapitre, au fait que mes deux journées d’écriture soient distantes l’une de l’autre ou si c’est parce que mon esprit est encombré par d’autres tâches. Il va en tout cas falloir faire des ajustements.
Le premier des ces ajustements a été la décision d’abandonner l’inktober, qui me prenait trop de temps. Quand j’ai participé au challenge l’année dernière, j’avais un emploi salarié à temps partiel et rien d’autre à faire à côté donc j’avais suffisamment de temps pour m’y consacrer. Cette année, je suis au chômage en fin de droits avec l’urgence de devoir trouver une solution financière. Autant dire que les conditions ne sont pas du tout les mêmes et que je n’ai pas l’espace mental disponible pour me lancer dans ce challenge. Toute la semaine, j’ai été stressée par le fait d’être en retard dans mon programme, que ce soit pour inktober ou pour le développement de mon activité d’artiste-auteur donc vraiment pas assez de plaisir par rapport aux bénéfices (inexistants) d’y participer.
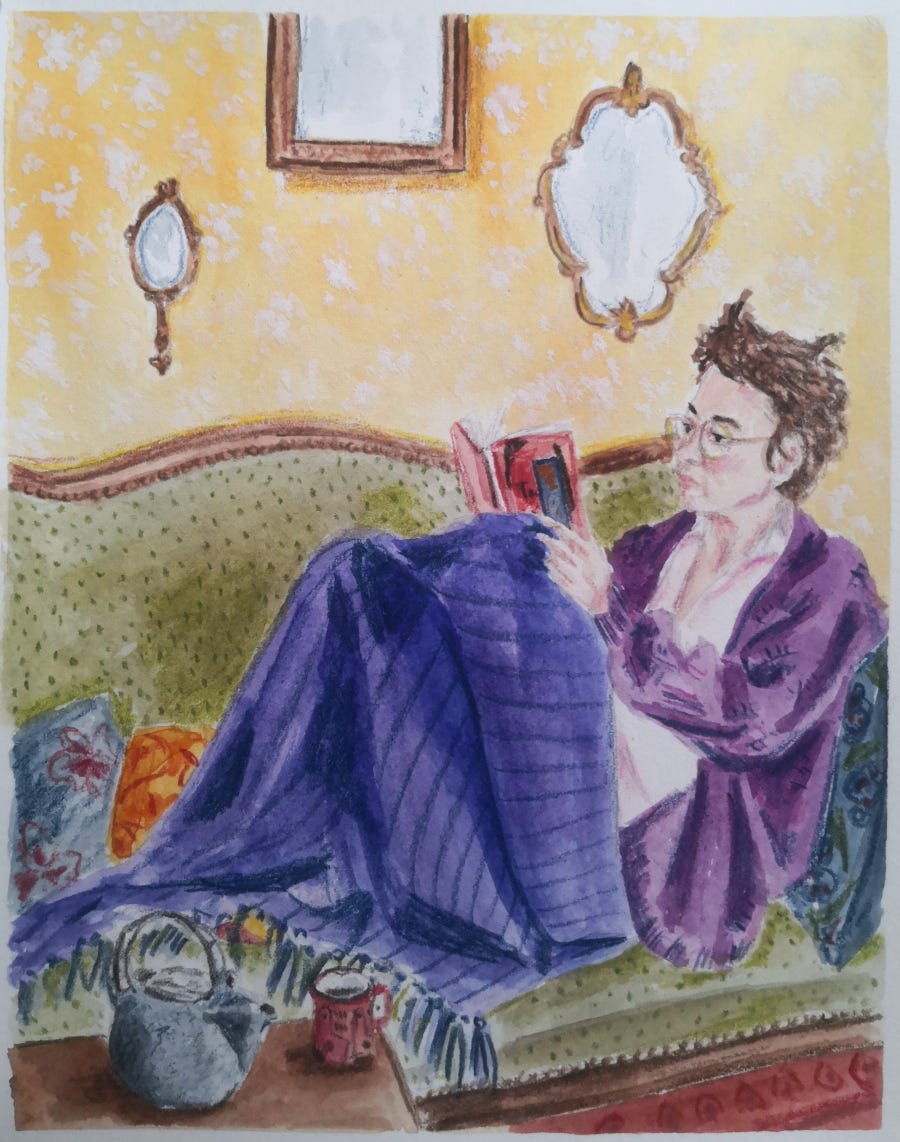
Je n’aime pas trop abandonner des projets sur lesquels je m’étais engagée (même si ce n’est que vis-à-vis de moi-même), mais j’ai déjà abandonné une thèse de doctorat sur laquelle j’avais travaillé pendant trois ans donc abandonner l’inktober 2024, c’est un peu du pipi de chat.
Je me sens moins stressée depuis que j’ai pris cette décision et je me consacre à 100 % à la question : comment vivre de mon art et de ma “création de contenu” comme on dit ? Pour l’instant, beaucoup d’idées fusent mais rien de très sérieux. Cela va nécessiter que j’y réfléchisse un peu plus avant de vous en parler. D’ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous remercie de m’avoir lue.
À dimanche prochain.
Cette semaine sur le blog
Vous n’avez pas besoin de connaître les détails de cette anecdote. Sachez seulement que je donnais des petits surnoms nuls aux inconnus du lycée