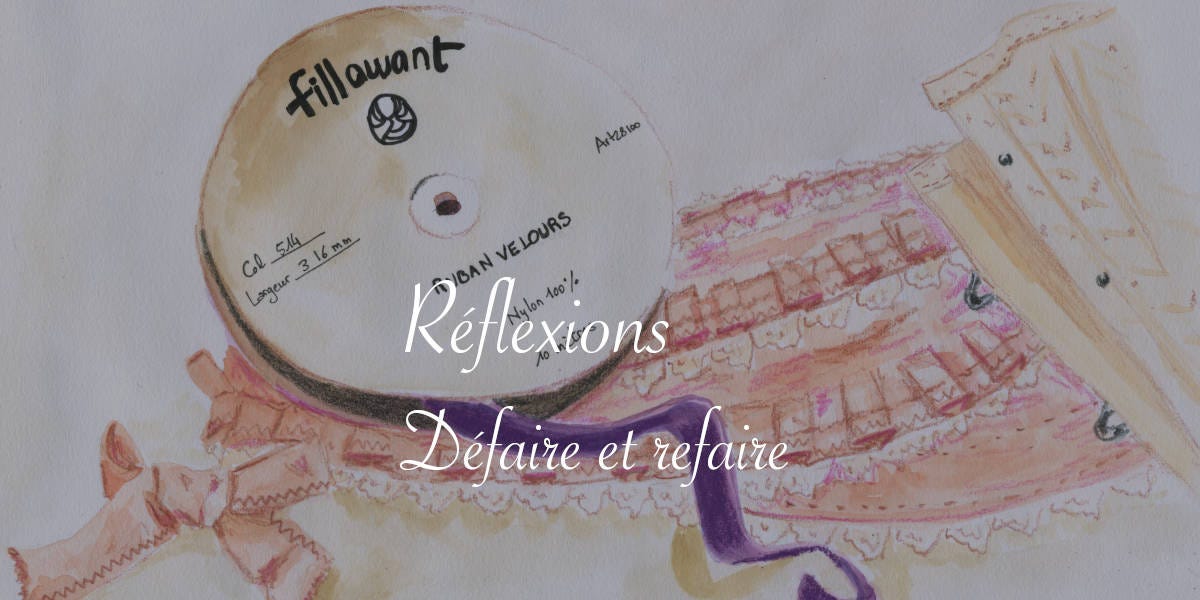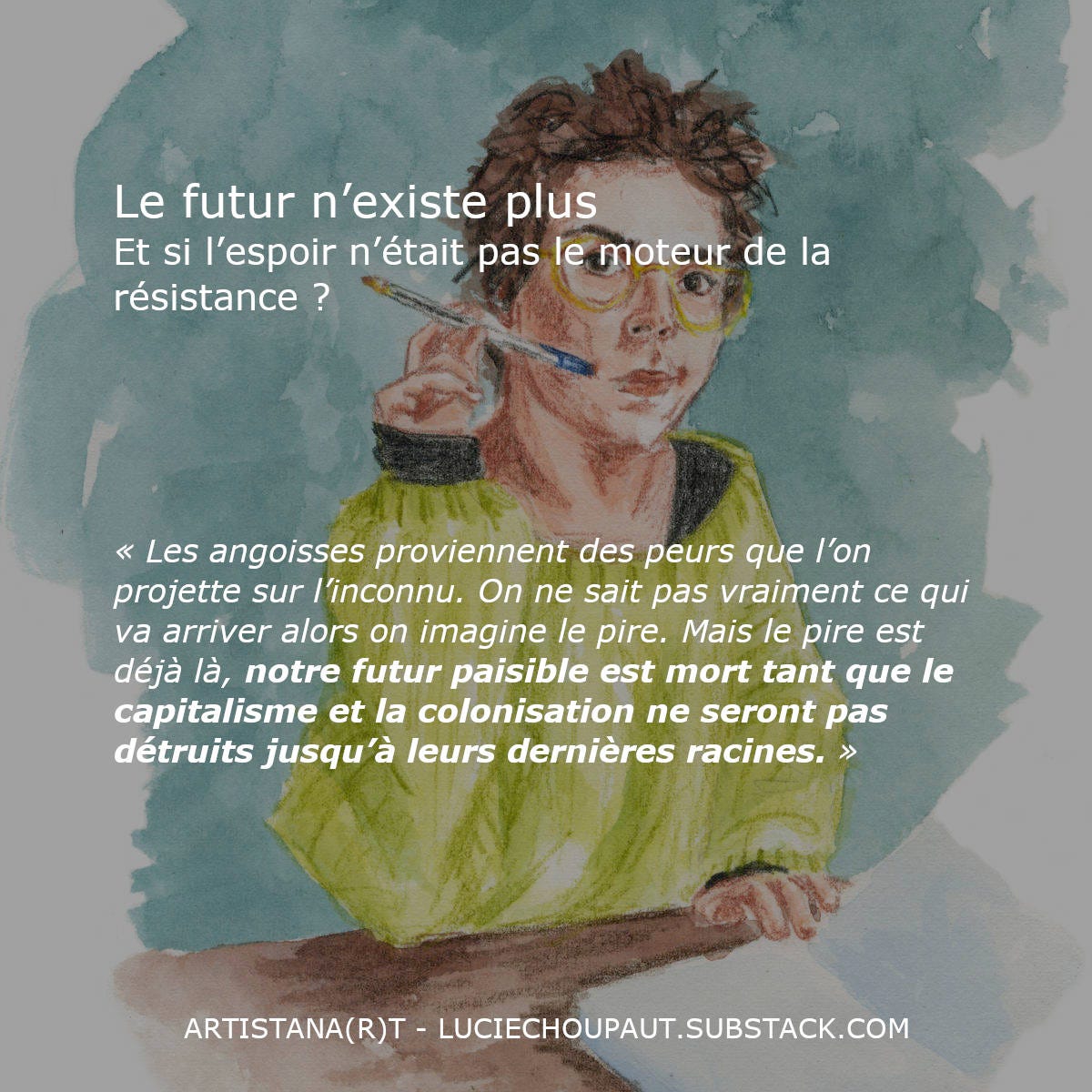Une fois n’est pas coutume, je me permets un avertissement avant de commencer cette lettre, car elle va faire référence au contexte politique actuel, qui n’a rien de réjouissant. Si vous ne vous sentez pas capable de lire du contenu là-dessus en ce moment, attendez d’être un peu plus solide mentalement. Je vous comprends. En ce qui me concerne, cela fait trois mois que je n’ai pas eu la force de lire un article du Monde diplomatique parce que c’est trop déprimant.
Si vous vous sentez l’envie de me lire, let’s go pour la suite.
La première trilogie Star Wars est sans conteste la série de films que j’ai le plus vue dans mon existence. Je ne sais pas exactement à quel âge je les ai regardés pour la première fois puisque j’ai l’impression de les avoir toujours connus, mais je me rappelle ma mère nous lisant les cartons d’introduction ce qui veut dire que nous étions petits.
Je pense qu’avec mes frères, nous avons regardé Un nouvel espoir, L’empire contre-attaque et Le retour du Jedi, à la louche au moins une fois par mois de nos 7 à nos 18 ans ce qui fait déjà un total de 132 fois sachant que depuis 20 ans je les ai à mon avis revus presque une fois par an. Autant dire qu’il n’y a probablement pas d’œuvre culturelle qui ait eu un plus grand impact sur le développement de mon imaginaire que cette première trilogie, que je continue de considérer sans aucune objectivité comme les meilleurs films de tous les temps.
J’ai donc toujours été galvanisée par les histoires de résistance. Ça a commencé avec Star Wars et ça a continué avec des récits de la seconde guerre mondiale. Je pense vraiment qu’il n’y a pas grand-chose qui m’émeuve plus que le sacrifice d’individus pour la beauté d’une cause qui les dépasse.
Le message du premier film Un nouvel espoir, c’est que l’espoir triomphe. C’est cet espoir de la victoire qui porte les rebelles pour se battre et mourir pour l’Alliance. D’un point de vue dramaturgique, c’est super, on veut que les gentils gagnent à la fin, mais quid de la vraie vie ?
Dans la vraie vie, et je lance peut-être une unpopular opinion, je ne trouve pas que l’espoir soit une émotion très positive et ce pour deux raisons :
La première, c’est que l’espoir est souvent déçu. Je ne sais pas ce qu’il en est de vous, mais c’est clairement mon expérience personnelle avec l’espoir. Combien de choses ai-je espérées qui ne se sont jamais réalisées ? Il y en a beaucoup trop pour les compter. Or, à chaque espoir déçu, c’est un petit coup de massue derrière la tête qui immobilise et décourage pour une durée plus ou moins longue. Élément moteur plutôt inefficace donc.
La deuxième raison c’est que l’espoir a un côté « pensée magique ». Tant qu’on espère, il y a une partie de nous qui se dit que peut-être la situation de merde va se résoudre comme par magie et qu’il n’y a qu’à attendre que ça arrive. À nouveau, c’est donc plutôt quelque chose qui ne favorise pas le mouvement.
On dit que l’espoir fait vivre, je dirais plutôt que l’espoir fait attendre et que ce n’est pas très constructif.
Je me suis longtemps demandée ce qui poussait des individus à s’engager dans la Résistance et à risquer leur vie. Y avait-il en elles et eux une part héroïque individuelle qui leur serait spécifique et qui ne se trouverait pas en chaque humain·e ? Ou alors quelle serait la recette pour passer d’un être individualiste à un être prêt au sacrifice ? Je crois que ces derniers mois m’ont donné des éléments de réponse.
Future is dead
Dans mon milieu social, l’image du futur qui allait être le mien était assez basique : j’allais devenir une vieille dame seule et un peu revêche, je devais donc cotiser pour ma retraite et m’assurer un certain confort matériel. Cela n’allait pas plus loin. Cependant, ce futur n’intégrait pas le fascisme.
La seule chose que je me rappelle de mes cours d’histoire au collège et au lycée, ce sont les cours sur la seconde guerre mondiale et la Shoah. Dans ma construction, il y avait cette idée de bon sens profondément ancrée que je vous retranscris à peu près comme je la pensais à quinze ans : « Toutes ces horreurs ne peuvent plus arriver parce que maintenant on sait. C’est bon, je suis perchée, ce problème humain a été réglé avant ma naissance, tant mieux pour moi ».
« Tant mieux pour moi »... Autant dire que je me sens profondément flouée par ce qu’il est en train de se passer.
Quand je me suis abonnée au Monde diplomatique il y a un an, j’ai pris la mesure de la montée des fascismes partout dans le monde, ce qui avait déjà pas mal écorné ma vision du futur. Depuis l’investiture de Trump et le salut nazi de l’autre connard, j’ai atteint, je crois, un nouveau palier.
Je vis (nous vivons) dans un monde où des neo-nazis sont à la tête de la plus grande puissance mondiale, dans un monde où le futur paisible que je m’imaginais, n’existe plus.
Or, contre toute attente, cette réalisation a calmé un certain nombre d’angoisses que je ressentais avant. Ce qu’il se passe en ce moment aux États-Unis, c’est je crois ce dont mon esprit avait besoin pour changer de paradigme : il n’y a plus de futur, il n’y a pas d’espoir. Les idées sociales ont perdu au profit du capitalisme. Les milliardaires fascistes ont gagné la guerre idéologique, du moins pour l’instant, et rien ne garantit que cela change de mon vivant.
Les angoisses proviennent des peurs que l’on projette sur l’inconnu. On ne sait pas vraiment ce qui va arriver alors on imagine le pire. Mais le pire est déjà là, notre futur paisible est mort tant que le capitalisme et la colonisation ne seront pas détruits jusqu’à leurs dernières racines.
S’il n’y a plus de futur, si rien ne peut me garantir de vivre une retraite paisible de vieille dame revêche, alors seul le présent compte. À quoi bon angoisser pour une retraite hypothétique, pour des projets sur le temps long, et même pour l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir en France puisqu’elle est déjà là et que maintenant, le seul outil dont nous disposons, c’est notre individualité1 : c’est-à-dire notre capacité de résistance à ce qui s’oppose à notre morale et à nos valeurs profondes.
Ce qui est intéressant, c’est que ce nouveau palier dans mon état d’esprit ne change pas grand-chose à mon présent. Les problématiques quotidiennes restent les mêmes, il faut quand même travailler pour se loger, se nourrir, etc. Il faut quand même vivre, même dans ce sentiment d’impuissance totale, même avec cette rage brûlante devant toutes les injustices, tous les mensonges, toutes les aberrations dystopiques dont nous sommes les témoins.
Être utile
Il y a quelques jours, j’ai lu un post de Laura Nsafou sur Instagram (Mrs Roots) dans lequel elle disait que dans le contexte actuel de lutte contre l’extrême droite il fallait trouver les endroits où nous étions utiles. Non pas les endroits où nous nous sentons utiles, mais ceux où nous le sommes effectivement.
Pour ma part, je trouve très compliqué de savoir où l’on est vraiment utile. Je suis convaincue qu’écrire et raconter des histoires alternatives l’est et que c’est important de continuer à le faire, mais est-ce la chose la plus utile à faire là tout de suite maintenant, je ne suis pas sûre.
Ma croyance est que cela se joue localement : que c’est là où nous vivons que nous pouvons avoir un impact. Selon que l’on soit un·e anarchiste isolé·e dans un village peuplé de gens d’extrême droite ou que l’on fasse déjà partie d’un réseau dense de militantes et militants de gauche en ville, on n’aura pas la même force de frappe et pas les mêmes capacités de résistance, mais en tant qu’individus nous avons au moins toujours la possibilité de désobéir.
J’ai l’impression, ou en tout cas je me demande si ce n’est pas comme ça que des gens, parmi lesquels parfois nos grands-parents, sont devenus Résistants. Parce qu’il n’y avait plus de futur et que seul comptait le présent.
Je vous remercie de m’avoir lue.
À dimanche prochain.
Cette semaine sur le blog
L’article de la semaine parle de défaire et refaire continuellement d’anciens projets et ce qu’il y a de positif à cela. Parmi ces raisons il y a le fait de lutter contre l’angoisse de la page blanche et celui de lutter contre la pensée capitaliste qui consiste à penser qu’il faut toujours plus plus plus.
Les derniers ateliers d’écriture
À ce propos je pense que c’est le bon moment pour lire ou relire Emma Goldman et sa pensée de l’anarchisme individualiste. J’avais écrit une petite revue d’une publication de Nada éditions ainsi qu’une poésie de lecture maladroite.