Lire des sciences humaines pour écrire des mondes imaginaires
Et quelques recommandations historiques
Un grand merci pour l’accueil que vous avez réservé à ma lettre de dimanche dernier et pour nos échanges. Sa lecture semble avoir fait du bien à plusieurs d’entre vous, j’en suis ravie. Je profite de cette courte introduction pour vous rappeler que ce sont les réactions et partages qui incitent les créateurices à continuer à diffuser leurs contenus sur le temps long. Au bout d’un moment, la mégalomanie se tarrit et il faut bien sentir qu’il y a du sens à continuer de produire ce qu’on produit. Ce sens est donné par les réactions des personnes qui reçoivent nos créations. Ainsi dans des journées chargées où on a plein de choses à faire, où on court après le temps, où on lit un article par-ci, regarde une vidéo par-là, n’oublions jamais qu’un like, un partage ou un commentaire est littéralement l’essence qui permet au moteur des créateurices de fonctionner sans quoi il s’enraye (j’ai zéro compétences en mécanique, je ne vais donc pas filer cette comparaison douteuse). Allez, c’est parti pour la lettre du jour.
Le week-end dernier, j’ai enfin retrouvé l’envie de tricoter. Après avoir passé un mois et demi à bouder le projet que j’avais péniblement commencé (un cardigan à torsades dont les explications me paraissaient incompréhensibles au mois de janvier), j’ai réussi à raccorder mes neurones pour me rendre compte que ce cardigan était en réalité très simple et agréable à tricoter.
Quand on tricote, on passe de longues plages de temps les mains occupées, ce qui nous laisse tout le loisir d’écouter des podcasts1. Ça tombe bien : j’ai deux mois et demi de retard sur mes écoutes et l’une des longues émissions écoutées cette semaine a inspiré le sujet de cette lettre.
Il s’agissait d’un épisode de recommandations de lectures sur la Révolution dans le podcast Paroles d’histoire (excellent podcast sur l’actualité de la recherche et des publications en histoire à destination des historien·nes et amateur·es éclairé·es. Me trouvant dans la cible, je ne saurais dire si c’est accessible à un public plus large, mais je vous glisserai des recommandations d’épisodes à la fin de cette lettre pour que vous puissiez aller y jeter une oreille). Dans cette émission, le spécialiste du XVIIIe siècle invité par l’hôte du podcast recommandait chaleureusement un ouvrage portant sur la publicité et les affiches placardées dans la ville au XVIIIe siècle2, ce qui m’a furieusement donné envie de le lire et qui m’a beaucoup fait réfléchir sur mon roman en cours.
Je récapitule pour les lecteurices qui ne seraient pas là depuis le début : Les mirages d’Abalon est un roman d’ambiance rétrofuturiste dans un monde imaginaire, commencé il y a très très longtemps (plus de 20 ans) que j’ai entrepris de re-réécrire intégralement en 2022. Si l’histoire a énormément changé entre la première version et celle que je suis en train de corriger, l’univers m’habite lui depuis deux décennies. Il s’est donc progressivement enrichi au fil du temps, mais un univers reste par définition gigantesque et il demeure plein de zones floues dans mon esprit. Certaines dont j’ai conscience, mais que je ne sais pas encore comment résoudre (par exemple, quelles sont précisément les relations internationales entre les différents pays de ma carte et qu’est-ce que cela sous-tend comme fonctionnements politiques chez chacune de ces entités) et certaines auxquelles je n’avais jamais pensé avant que quelque chose ne fasse naître cette réflexion dans mon esprit.
En écoutant l’historien de l’émission parler de ce livre décrivant la vie des rues françaises au XVIIIe siècle, j’ai réalisé que je n’avais encore jamais réfléchi à l’affichage dans les rues de ma propre cité imaginaire. Or, cette question a son importance dans le récit. Il y a notamment des affichages transgressifs sur les murs qui font partie intégrante de l’histoire, ce qui signifie que je dois penser l’affichage légal. Je dois me demander à quoi ressemblent les rues de ma cité, non pas seulement à l’échelle démiurgique (vraiment pas sûre que ce mot existe), mais très concrètement à la hauteur de regard de mes personnages : que voient-ils précisément ? Avec quels objets urbains interagissent-ils ? À quoi ressemble le sol ? Est-ce que les murs sont propres ou sales ? Y a-t-il des espaces d’affichages légaux ? Si oui, où se trouvent-ils et qui a le droit de les utiliser ?
Plein de questions que je ne m’étais pas forcément posées et auxquelles je n’ai pas encore de réponse précise. J’ai donc eu une furieuse envie d’acheter ce livre sur la publicité dans la ville au XVIIIe siècle, à la fois parce que j’adore l’histoire et que ça a l’air passionnant, mais aussi parce que ça pourrait me donner des idées pour approfondir mon roman.
Je m’aperçois que si je suis une lectrice de romans depuis toujours (sans être une grosse lectrice, je pense que j’ai au moins depuis l’adolescence toujours un roman en cours de lecture), ce sont aujourd’hui les livres théoriques de sciences humaines qui m’apportent le plus d’inspiration.
Petit éloge des sciences humaines
Quand je me suis lancée dans ma thèse d’histoire alors que je n’avais pas du tout le niveau théorique pour le faire, j’ai lu énormément pour rattraper mon retard et j’ai connu des épiphanies intellectuelles incroyables. La première d’entre elles a été de découvrir réellement ce qu’était la discipline historique, à savoir une démarche méthodologique d’analyse de sources pour comprendre les sociétés du passé ce qui laisse une grande marge d’interprétation pour les événements dont les sources sont lacunaires.3
Si cette thèse a été la pire des idées pour ma stabilité financière, ma santé mentale et mon avenir professionnel, c’est probablement la meilleure chose qui me soit arrivée du point de vue de mon enrichissement intellectuel et créatif. C’est grâce à cette thèse que j’ai commencé à lire des livres qu’il ne me serait jamais venu à l’esprit de lire et que j’ai peu à peu musclé mon sens critique. Ces trois ans passés à lire des livres d’histoire et de sociologie m’ont amenée à la conclusion que je voulais passer ma vie à lire la recherche des autres parce qu’il n’y a rien de plus passionnant et c’est la raison pour laquelle j’ai continué à acheter des éditions scientifiques après avoir complètement abandonné ma thèse et le monde de la recherche (que je déteste par bien des aspects).
Bref, il n’y a rien qui stimule plus ma réflexion qu’un ouvrage universitaire et rien qui ne me donne plus envie de retourner dans mon univers imaginaire, qui serait presque comme un mini-laboratoire expérimental.
J’en parlais d’ailleurs déjà un peu dans cette lettre :
Je ne me suis jamais considérée comme une créatrice d’univers. À dire vrai, c’est un peu par les hasards de la vie et ma personnalité opiniâtre que je me retrouve aujourd’hui à écrire un roman dans un monde totalement inventé. En principe, je suis beaucoup trop paresseuse pour me lancer dans une telle entreprise et j’espère, en toute sincérité ne jamais avoir à réécrire un roman dans un monde imaginaire4. Et pourtant, je dois bien reconnaître qu’il y a quelque chose de plaisant à inventer des fonctionnements de sociétés alternatifs et à se perdre dans plein de petits détails.
Je comprends complètement que les conseils d’écriture à destination des écrivain·es en herbe se concentrent sur l’objectif final, soit le fait d’arriver à aboutir une histoire qui se tienne. Néanmoins, en ce qui me concerne, je crois que cette dimension là n’occupe que 50 % de mes pensées. L’autre 50 % de réflexion est, lui, occupé à décortiquer le monde réel pour proposer un univers imaginaire riche, réfléchi et déconstruit dans le sens politique du terme. Quel monde ai-je envie de proposer à lire, dans ses aspect positifs comme négatifs ? Comment je travaille à construire une société qui se distingue de notre propre société capitaliste, qui reste suffisamment proche de nous pour toucher les lecteurices, mais qui s’en éloigne suffisamment pour ouvrir d’autres perspectives intellectuelles et politiques ?
Le fait d’écrire une histoire prenante avec des personnages chouettes et des enjeux intéressants est évidemment au cœur de ma réflexion, personne n’a envie de lire une encyclopédie au petit dèj, mais exactement au même niveau, il y a cette réflexion de fond qui sans aucun doute allonge mon processus de travail. Chaque lecture de sciences humaines ouvre une nouvelle fenêtre de pensée que je peux décider de prendre en compte ou non, mais qui ajoute des couches sur des couches.
Exactement comme avec l’aquarelle, qui nécessite plusieurs passages de peinture pour être détaillée et contrastée, je trouve passionnant de me dire que chaque lecture universitaire apporte un peu plus de profondeur et de contraste à l’univers que j’essaye de créer. Ce n’est ni efficace ni rapide, mais j’adore cette sensation vertigineuse d’une piste de réflexion nouvelle qui doit être défrichée5.
Bref, je ne sais pas trop où je vais avec ces pensées. Ce qu’il faut retenir c’est que j’avance (très) lentement, mais sûrement sur les corrections de mon deuxième roman. Je suis enfin arrivée à bout du chapitre 10 (que j’ai dû intégralement réécrire) et j’ai commencé les corrections du chapitre 11, qui devraient être un peu plus faciles parce que je suis plus à l’aise avec le personnage principal du chapitre et ce qui lui arrive. Je suis toujours fan de mon histoire et de mon univers et j’aimerais vraiment beaucoup que des gens puissent les découvrir un jour donc il s’agit de continuer à travailler.
Je vous laisse avec mes recommandations d’épisodes du podcast Paroles d’histoire.
Je vous remercie de m’avoir lue.
Bonne écoute et à dimanche prochain.
Recommandations d’émissions du podcast Paroles d’histoire
Le premier épisode que je vous recommande est un entretien avec Claire Andrieu à propos de son ouvrage Tombés du ciel. Le sort des pilotes abattus en Europe 1939-1945. J’ai trouvé l’émission tellement passionnante que j’ai acheté et lu l’ouvrage. J’en avais d’ailleurs fait un article sur mon blog en 2022. C’est peu dire que j’ai trouvé cette lecture géniale.
Le deuxième épisode que je vous recommande est un entretien avec Julie Pagis à propos de son livre Le prophète rouge. Enquête sur la révolution, le charisme et la domination. Là encore, j’ai trouvé le sujet tellement passionnant que j’ai acheté et lu l’ouvrage (terminé il y a quelques jours).
Enfin, une recommandation peut-être un peu plus pointue, mais j’ai trouvé vraiment très intéressants les deux premiers épisodes de la série “La fabrique des Annales” qui accompagne chaque nouveau numéro de la revue Annales. Histoire, Sciences sociales. Les publications dans les revues présentent vraiment la recherche la plus récente et c’est très stimulant. Le dossier du premier épisode traitait des cahiers de doléances, tandis que celui du deuxième épisode traite de la dimension économique des empires coloniaux, c’est très intéressant : La fabrique des Annales (n°2) : un Empire bon marché
J’espère que ces recommandations vous inspireront et vous donneront envie d’aller les écouter. N’hésitez pas à me faire un retour si c’est le cas.
Les derniers ateliers d’écriture
Cette semaine sur le blog
L’article de la semaine est un petit texte poétique racontant un lieu qui n’existe pas encore, mais que nous avons en tête avec mon amoureux : l’Atelier d’Augusta.
Ouverture des commandes personnalisées : portraits de maisons
Les maisons sont les personnages d’une histoire, et c’est cette histoire que je vous propose de raconter en illustrant un lieu qui vous est cher. Mon carnet de commandes est ouvert, vous pouvez consulter l’offre sur cette page.
Certain·es tricoteureuses parviennent à suivre des films complexes ou à lire des livres en tricotant, ce dont je suis personnellement incapable.
Le livre recommandé en question : Laurent Cuvelier, La ville captivée : Affichage et publicité au XVIIIe siècle, Paris Flammarion, 2024.
Si vous vous demandez comment j’ai pu entrer en doctorat avec ce niveau de naïveté sur ma propre discipline, sachez que moi aussi.
Il est évident que ça pourrait arriver car… je suis maso ?




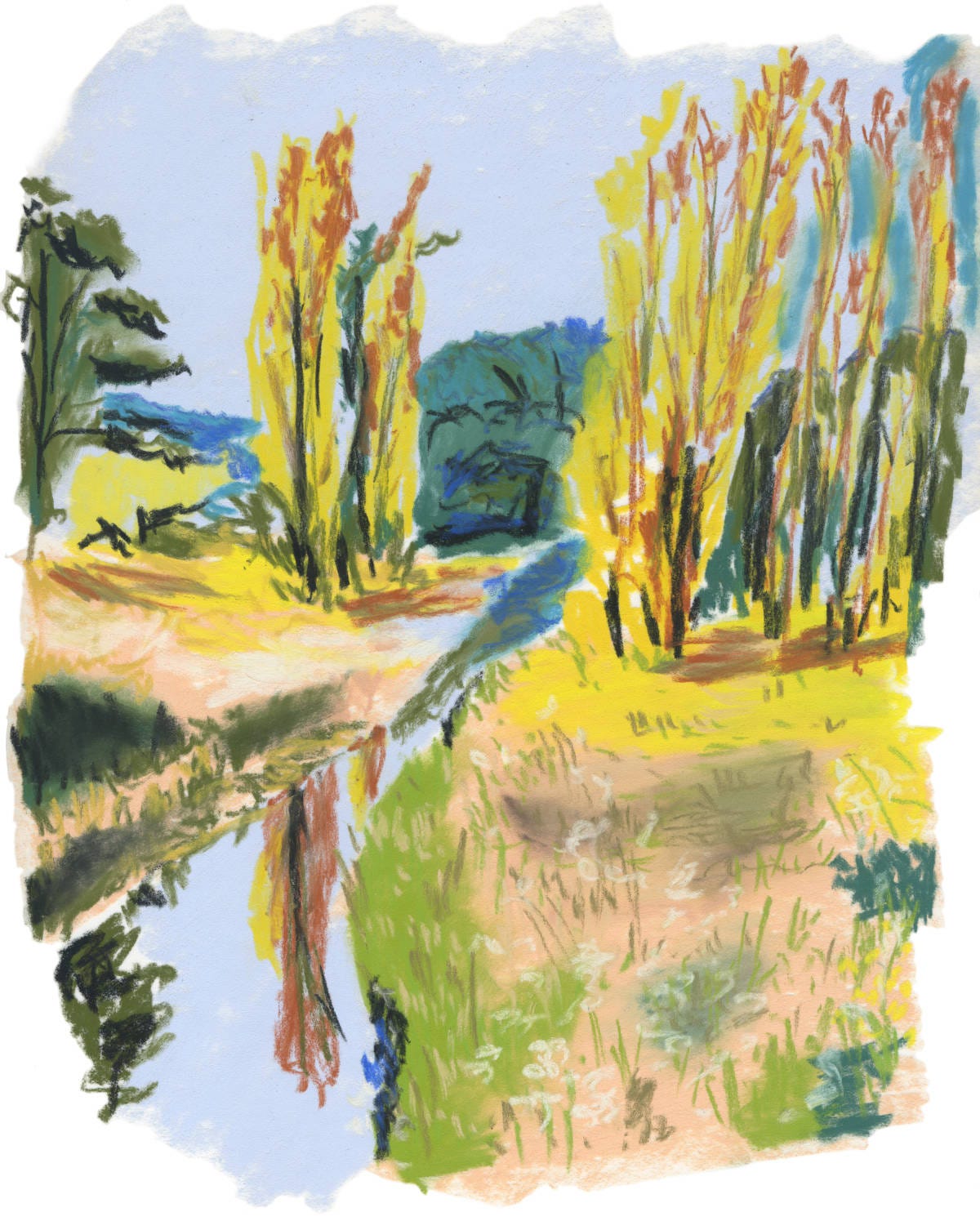




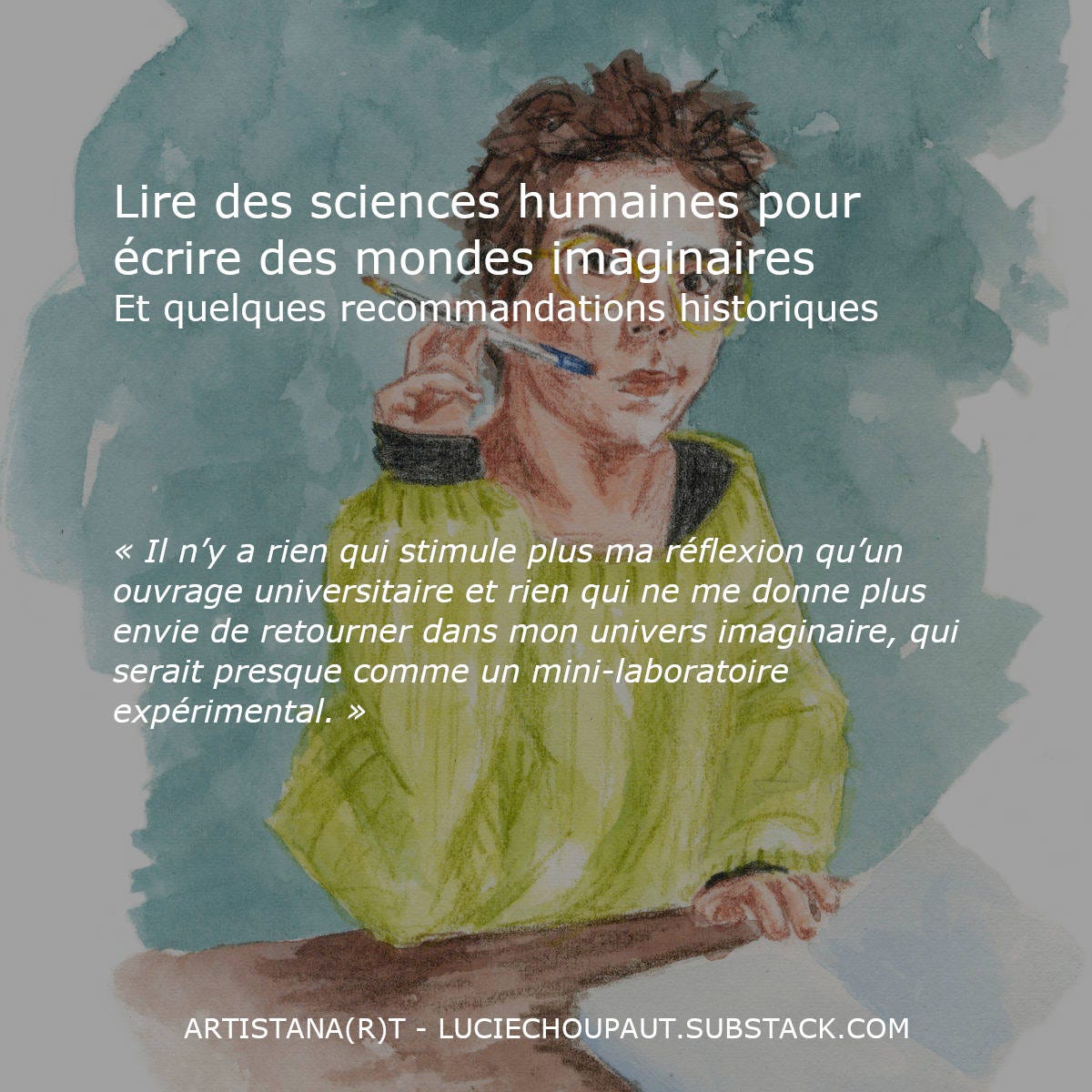
En tant que lectrice, j’adore les descriptions de sociétés imaginaires. Pour parler d’un exemple que tout le monde connaît : Harry Potter. Quand j’ai découvert les bouquins, j’ai adoré le suivre faire son premier shopping de rentrée, la découverte du train, de l’école, les cours etc. Presque, il m’est arrivé de regretter les grandes aventures qui nous distrayaient des descriptions. D’ailleurs, c’est peu dire que j’ai été déçue quand ils ne sont pas retournés à l’école en dernière année pour aller camper dans la pampa. Et ça m’a fait la même chose pour beaucoup de romans de SF ou fantasy… ou même des romans historiques d’ailleurs. C’est presque ce qui me fascine le plus, et qui me fait apprendre des choses aussi.
Comme, comment ne pas dire ce je pense tout en ne disant rien de faux avec les Aes Sedai.
Bref, merci pour tes articles chaque semaine. J’ai aussi trouvé ton plaidoyer pour les commentaires très convaincant !